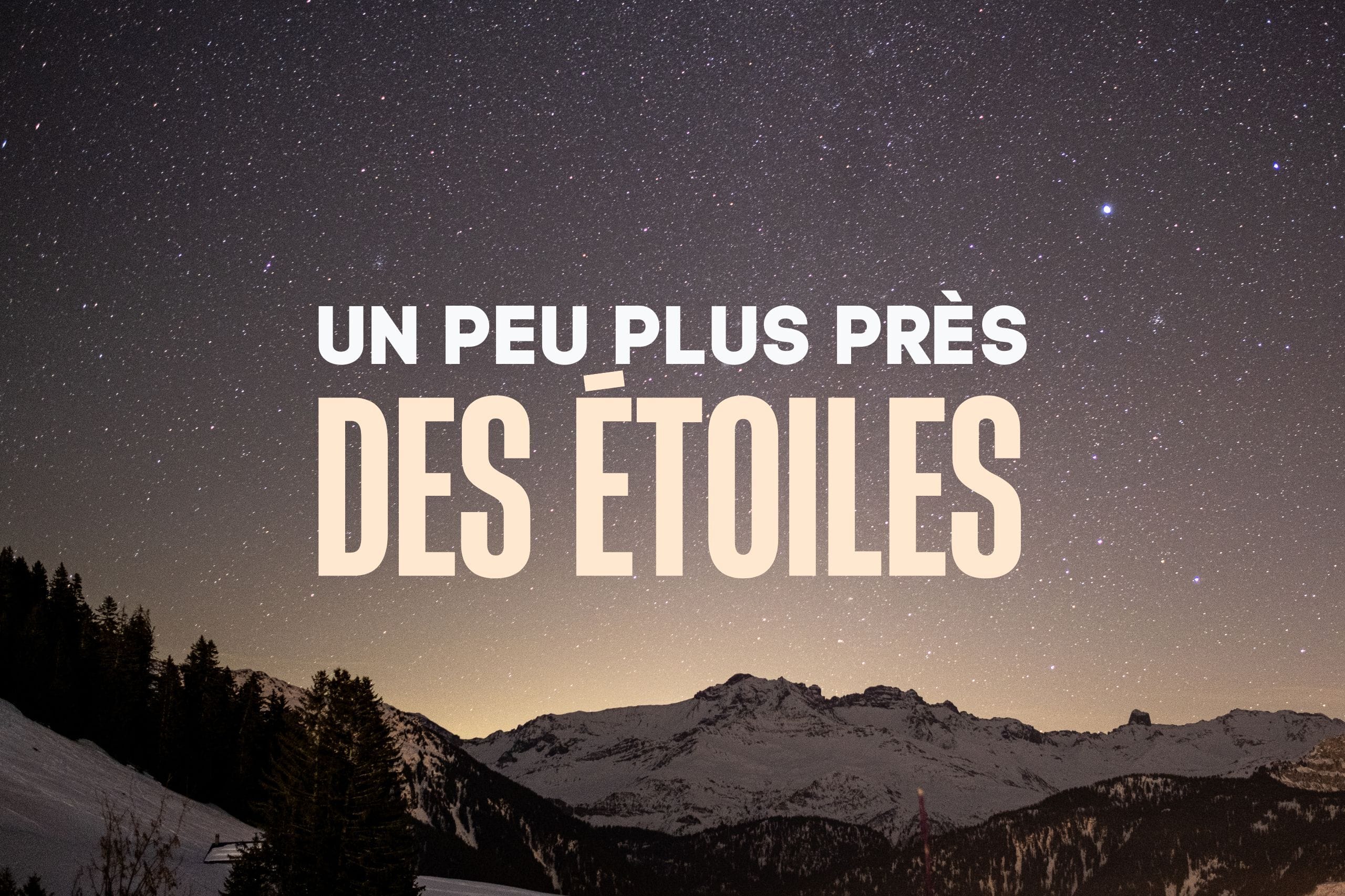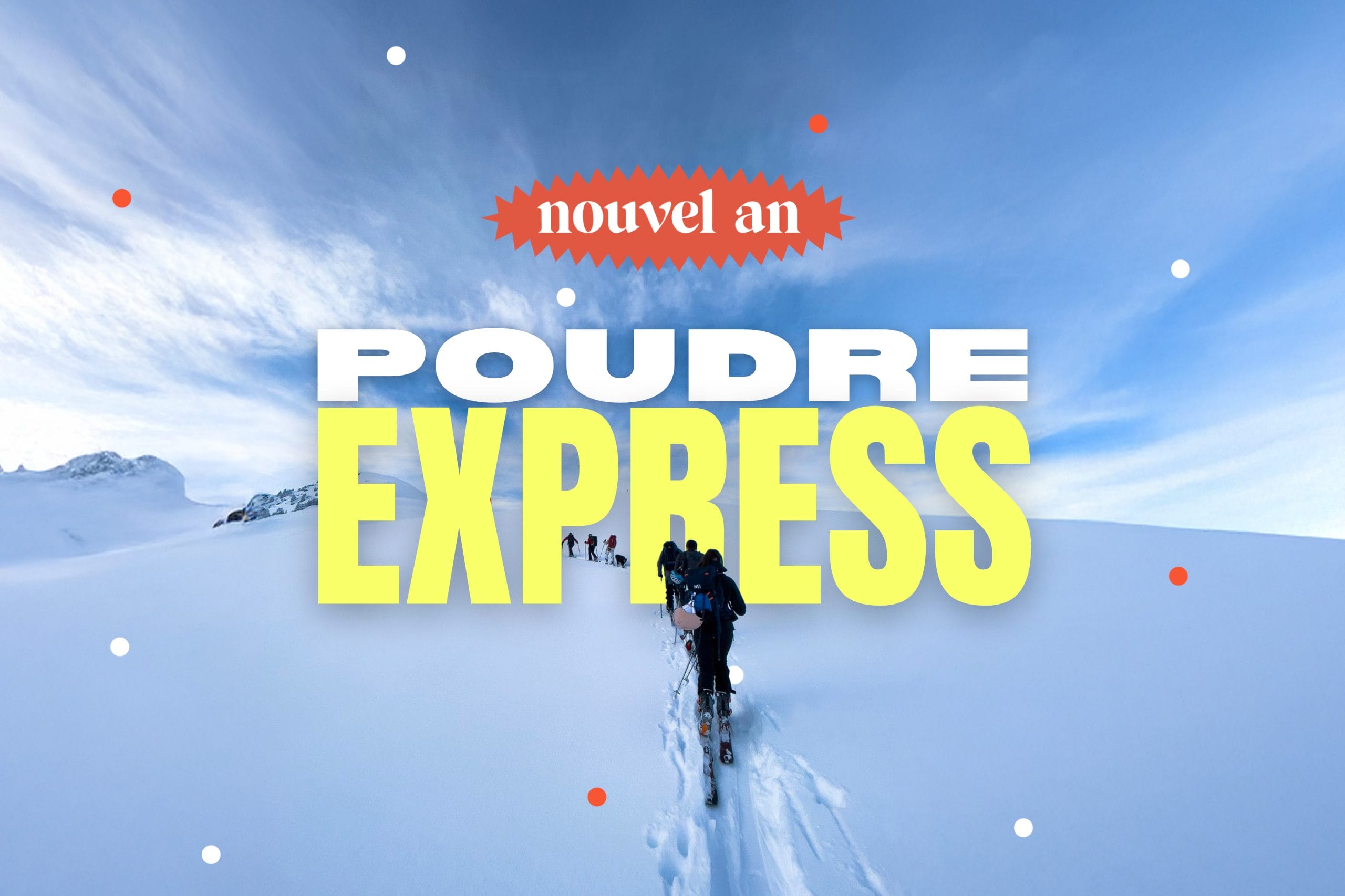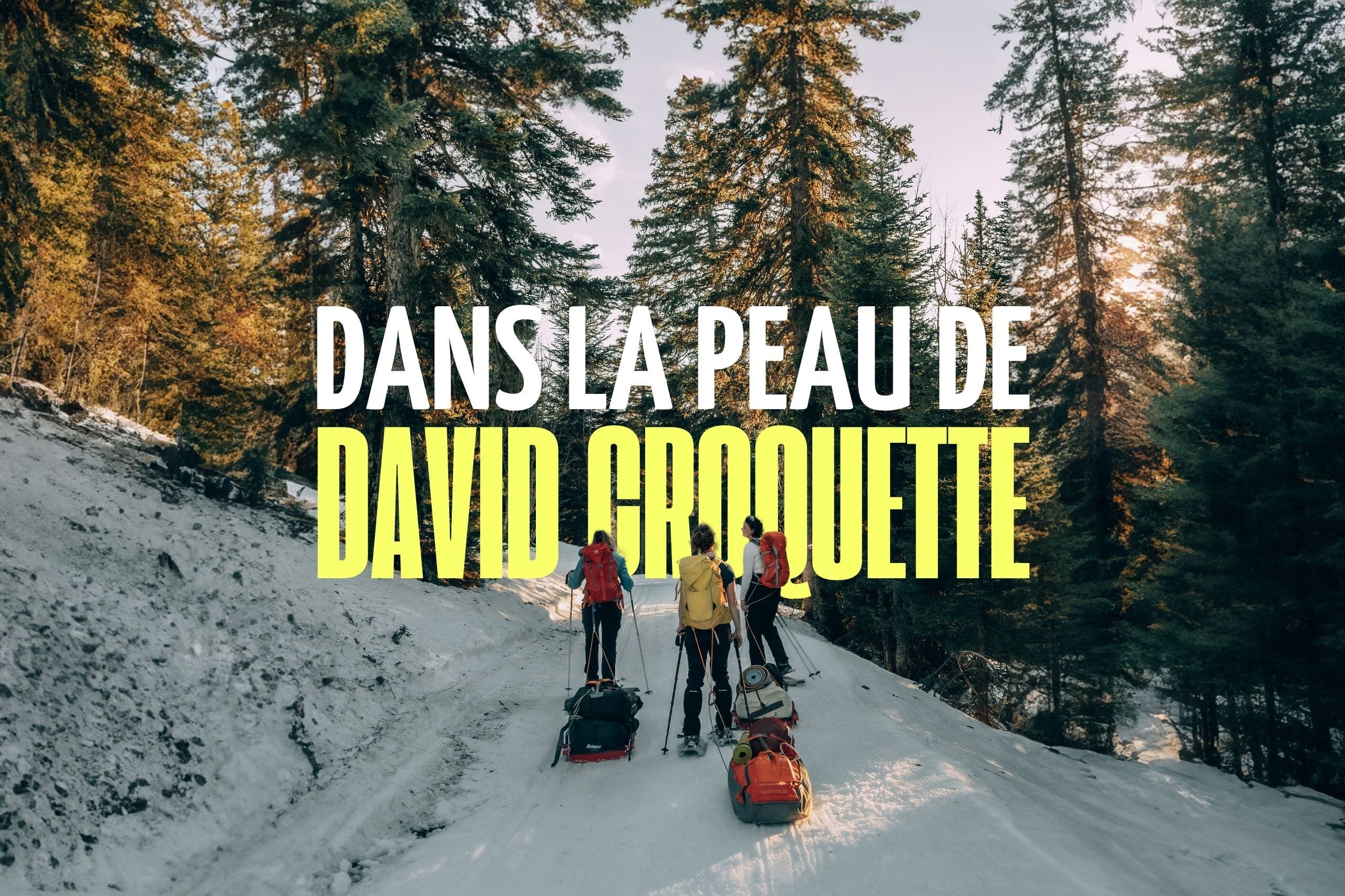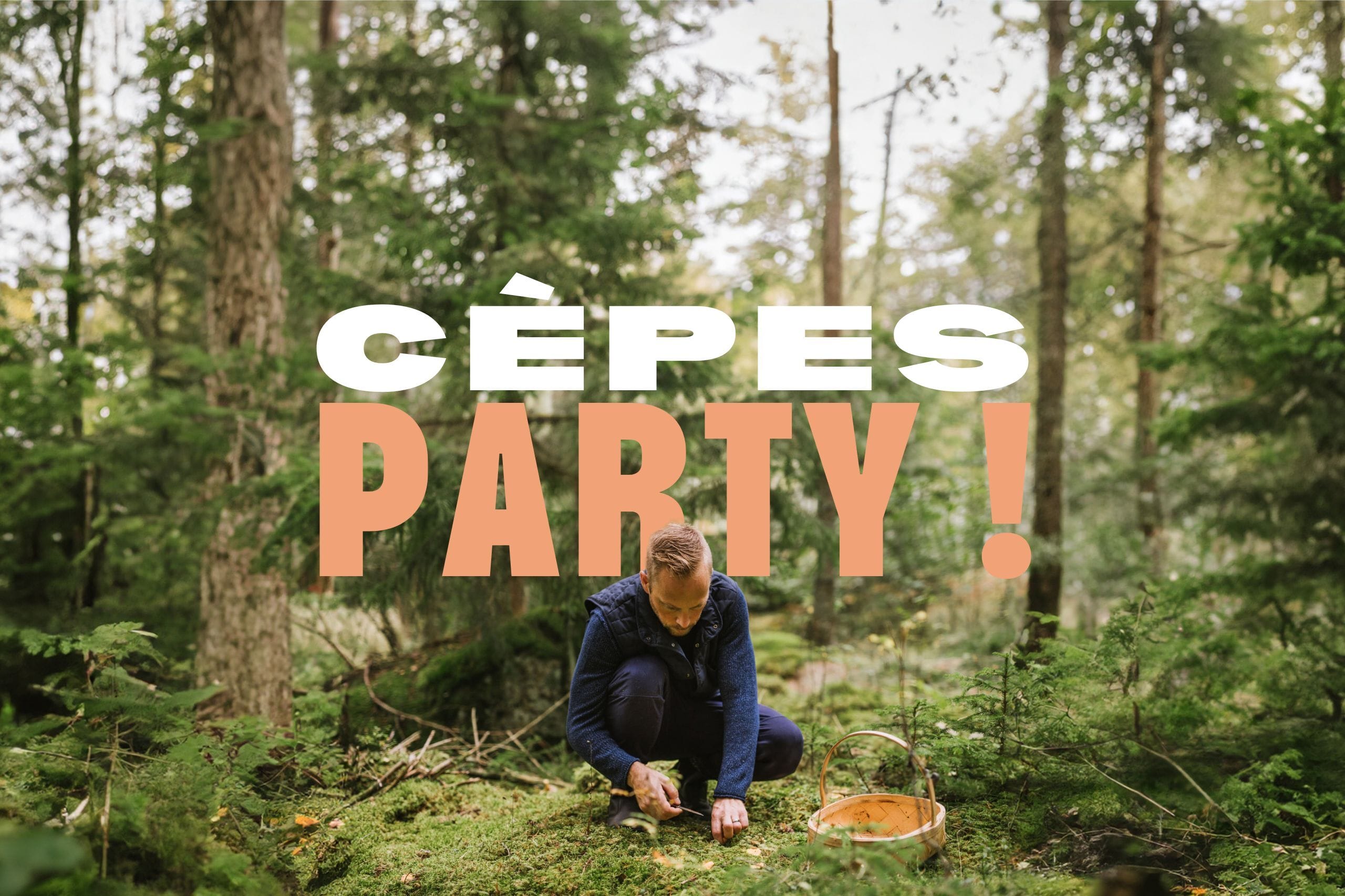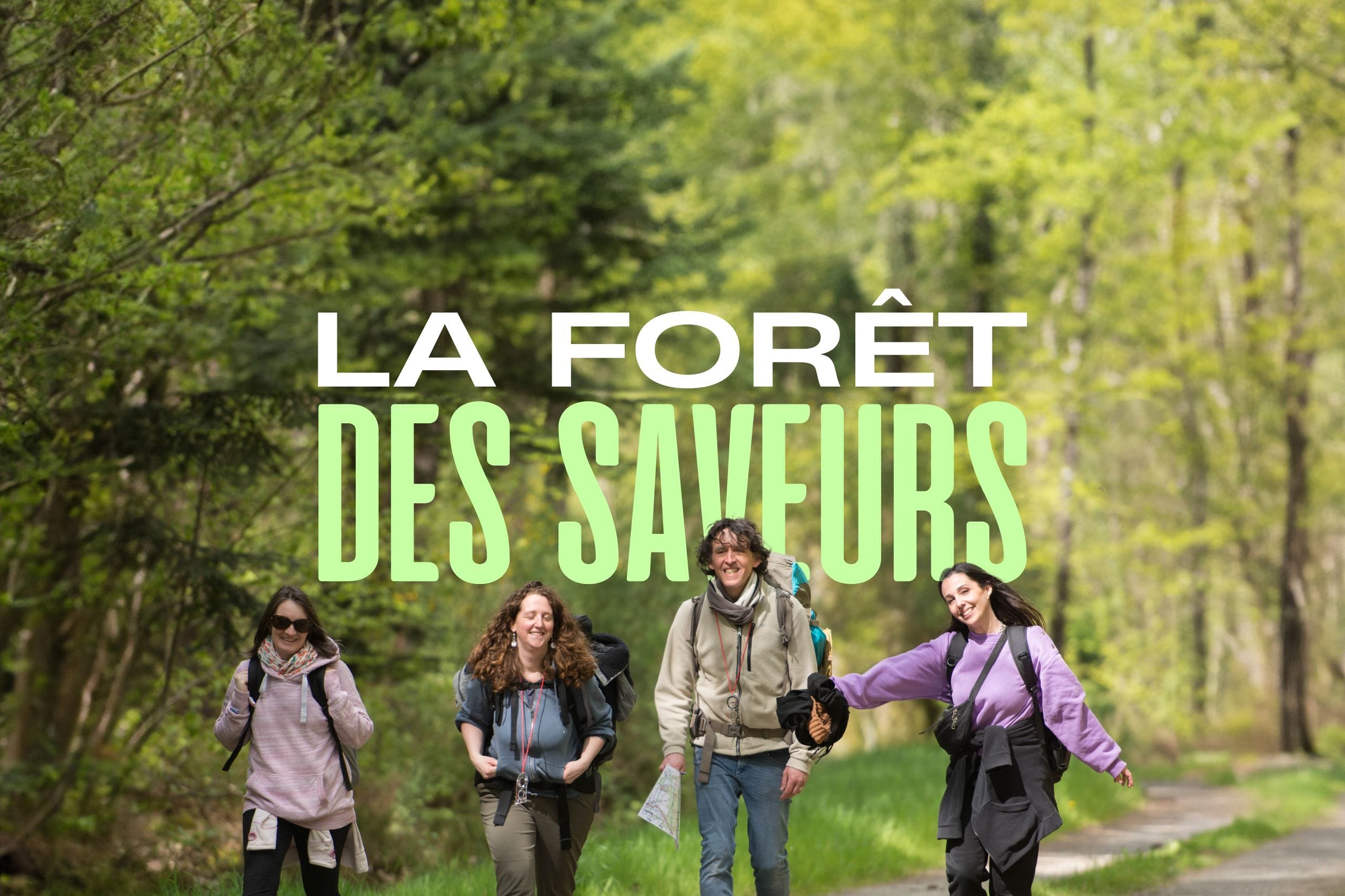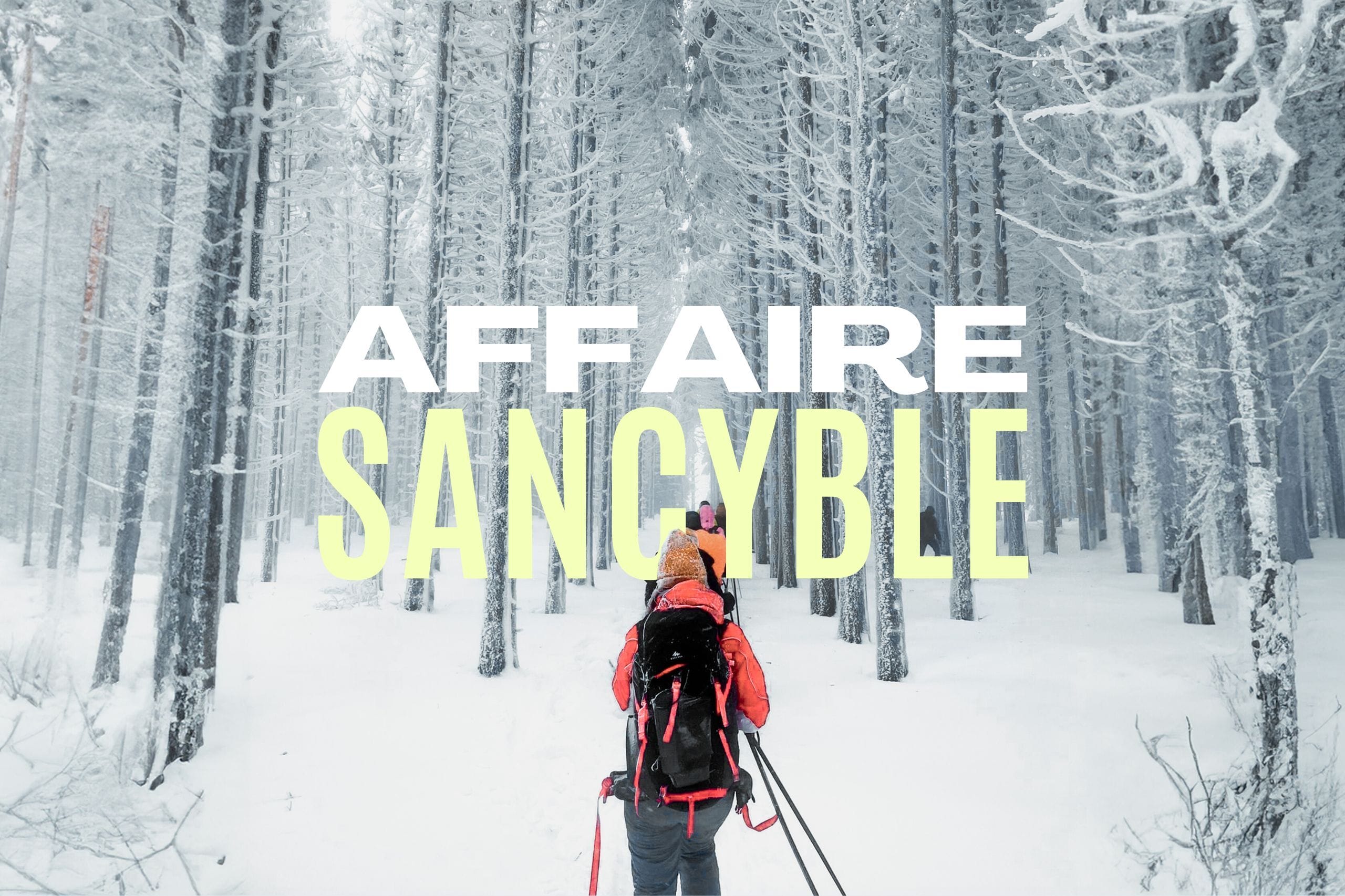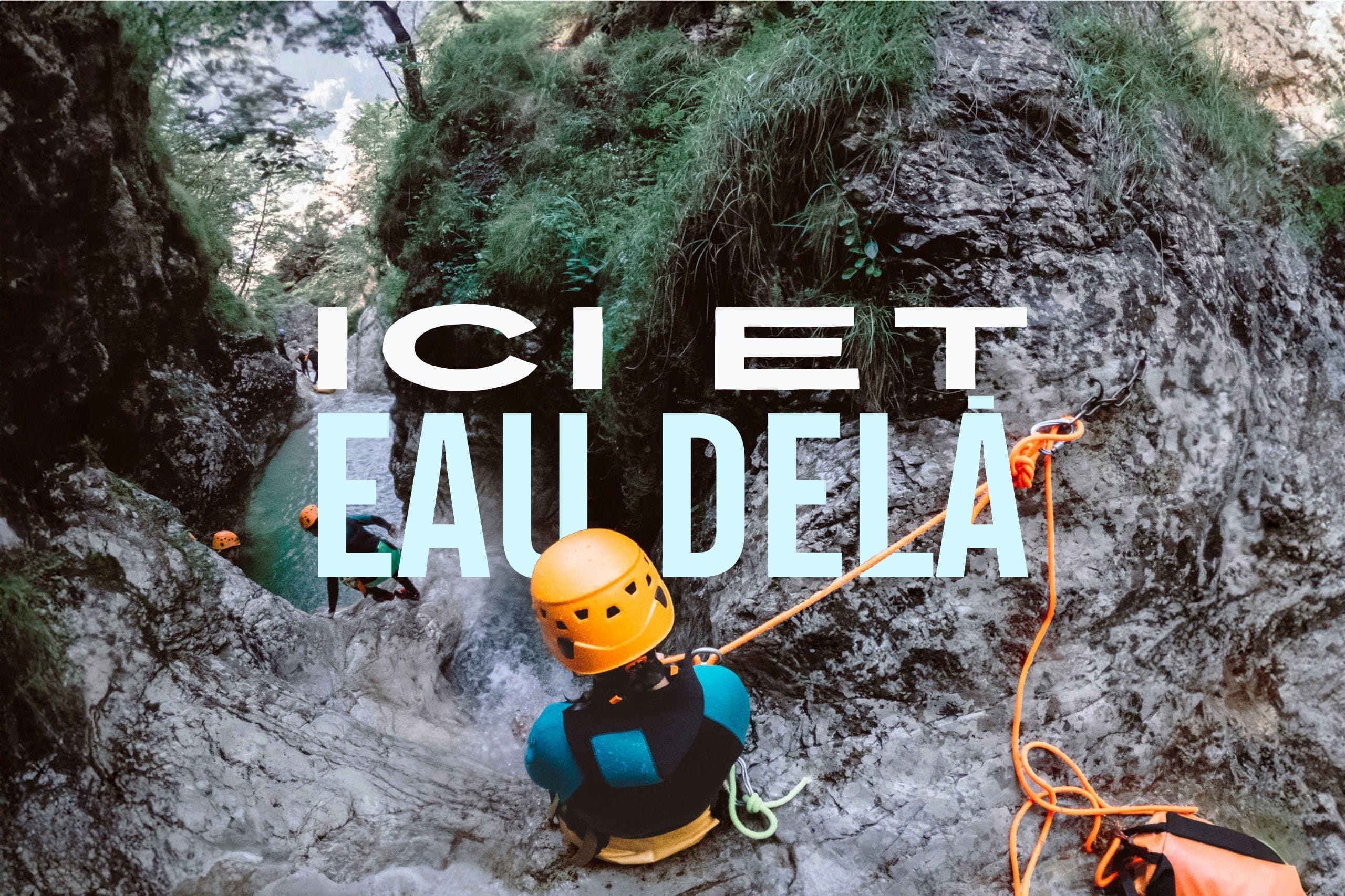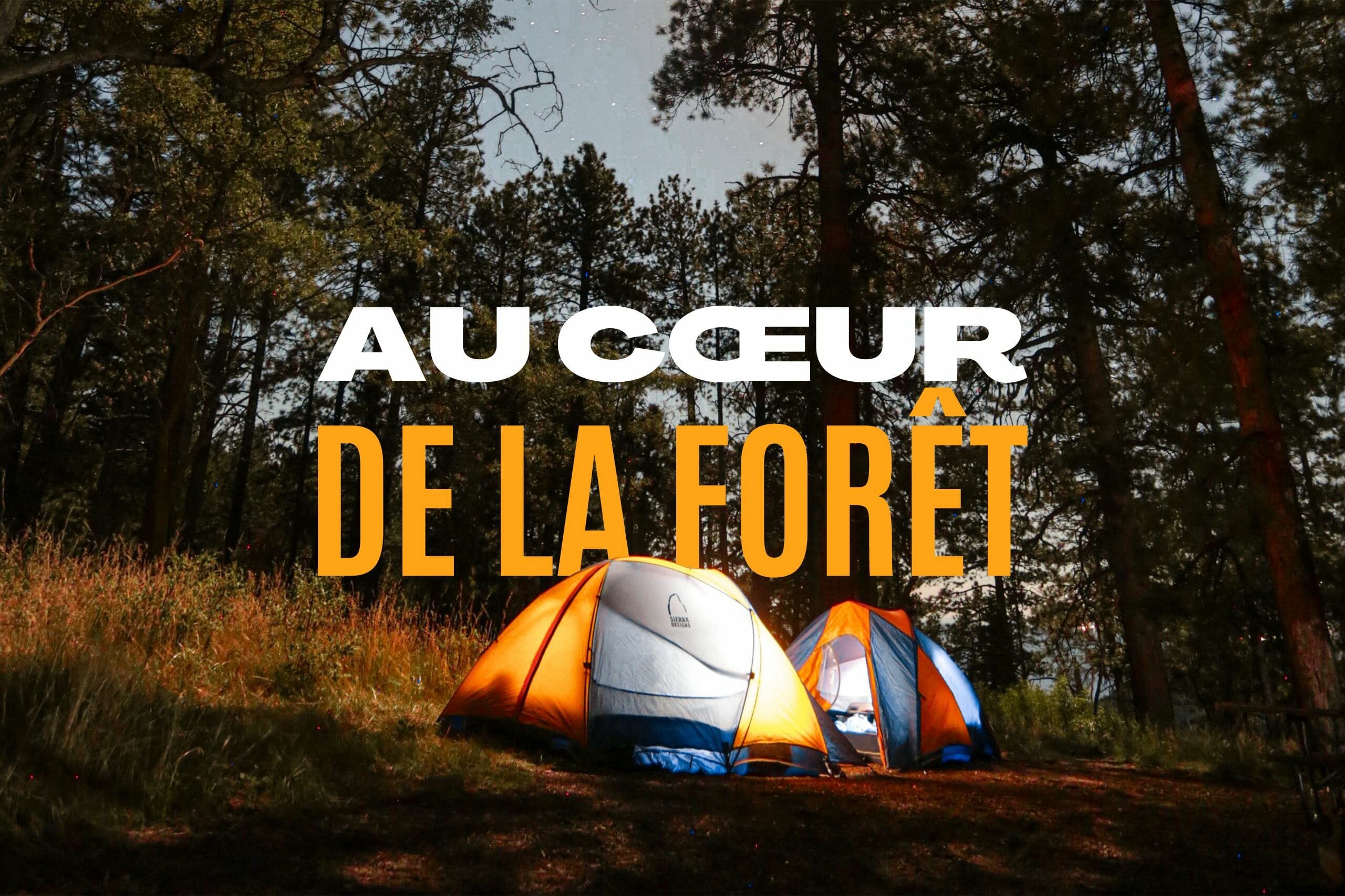« C’était marqué sur l’appli que c’était une balade ». Oui, mais l’appli ne voyait pas vos claquettes, ni le dévers vertigineux sur l’arête finale. En montagne, les sentiers ne se valent pas. Ils peuvent aller de la promenade familiale à la traversée engagée avec passage équipé. Et une méconnaissance de la difficulté peut transformer une jolie sortie en gros moment de solitude (ou de panique).
Alors, pour marcher malin et chaussé correctement pour votre prochain voyage trek, on vous explique les différents types de sentiers, leurs niveaux, les systèmes de balisage, et comment bien se préparer en amont et sur le terrain.
Les grands types de sentiers : bien plus qu’une question de balisage
On distingue généralement trois grandes familles de sentiers en montagne :
- Les sentiers de promenade
- Les sentiers de randonnée
- Et les sentiers alpins.
Leur niveau de difficulté varie en fonction de la pente, de l’exposition, de la technicité du terrain et de la signalisation (quand il y en a).
Les sentiers de promenade sont les plus accessibles. Ce sont souvent d’anciens chemins ruraux ou forestiers, stabilisés, avec peu ou pas de dénivelé, idéals pour les balades en famille, même avec une poussette tout-terrain. Le balisage est généralement simple et les risques limités. Une bonne paire de baskets suffira largement.
Les sentiers de randonnée montent d’un cran. Ils peuvent comporter du dénivelé, des passages rocheux ou instables, des traversées de torrents, ou de courtes portions aériennes. Le balisage est souvent présent (marques jaunes, rouges ou blanches selon les niveaux), et les cartes IGN deviennent utiles si l’itinéraire est moins évident. Ce sont les sentiers typiques des GR et GRP (grandes randonnées, souvent balisées en blanc et rouge).
Enfin, les sentiers alpins ou de haute montagne relèvent d’une toute autre catégorie. Ici, le sentier peut être étroit, escarpé, voire invisible. On y trouve des éboulis, des arêtes, des zones de pierriers ou des pentes raides. Ces sentiers peuvent comporter des équipements (mains courantes, câbles, échelles), mais ils supposent surtout une vraie expérience de la montagne. Dans certains cas, l’itinéraire se rapproche de l’alpinisme facile (ou « rando alpine »).
Le balisage : apprendre à lire la montagne
En France, le balisage n’est pas uniformisé au niveau national, mais on retrouve quelques standards :
- Sentiers de promenade : marques vertes ou panneaux bois indiquant des boucles courtes.
- Sentiers de randonnée : balisage jaune (local), blanc-rouge (GR), ou blanc-jaune (GRP).
- Sentiers difficiles / montagne : parfois balisage bleu, rouge ou absence de balisage, uniquement cairns ou peinture réduite.
Il faut savoir que l’absence de balisage ne signifie pas toujours que l’on s’est perdu : certains itinéraires en montagne sont volontairement peu marqués pour ne pas surfréquenter une zone fragile. Dans ces cas-là, les cairns (amas de pierres) deviennent vos meilleurs alliés… sauf quand dix itinéraires parallèles ont chacun les leurs.
La lecture de carte IGN (ou OpenTopoMap, ou Geoportail) reste essentielle. Apprenez à reconnaître les courbes de niveau, les pentes raides, les barres rocheuses, les zones forestières ou les cols. Et si votre sens de l’orientation se limite à retrouver la cafétéria d’une station de ski, partez avec quelqu’un de plus aguerri ou formez-vous avant d’envisager un itinéraire complexe.
Repérer et préparer son itinéraire : avant le départ, pas pendant
Partir en montagne, ça commence bien avant la première foulée. Le choix de l’itinéraire doit prendre en compte plusieurs éléments : la distance, le dénivelé, la nature du terrain, la météo annoncée, votre expérience, et celle du groupe. Trop souvent, on sous-estime la durée d’une boucle ou on surestime ses capacités. Résultat : descente de nuit, fin de journée sous la pluie, ou raccourci foireux qui devient anecdote à raconter plus tard.
Utilisez des topos papier (type Rando Éditions, Cicerone, ou les guides locaux), ou des applis comme OpenRunner, Visorando, Whympr, AllTrails, ou IGNrando. Mais attention : aucune trace toute faite sur une appli ne remplacera pas la compréhension du terrain. Il est préférable de connaître les points de sortie possibles, les refuges ou abris proches, et d’avoir toujours une carte en dur dans le sac en cas de panne de téléphone ou d’absence de réseau.
Que mettre dans son sac selon le type de sentier ?
La règle d’or : plus le sentier est exposé ou technique, plus vous devez être autonome. Sur une promenade balisée, une gourde, une veste légère et des lunettes de soleil peuvent suffire. Mais sur un sentier alpin, on entre dans un autre monde.
Vous aurez besoin de chaussures de montagne rigides (ou au minimum des chaussures de randonnée montantes avec semelle crantée), de bâtons pour stabiliser les appuis, d’une trousse de secours, d’une frontale, d’une couverture de survie, d’un coupe-vent ou d’une doudoune légère, et d’une carte + boussole. Pour certains itinéraires, un casque est recommandé, notamment en cas de chute de pierres ou de passage dans des zones très fréquentées, et parfois un baudrier et une corde d’alpinisme sera nécessaire. Ainsi que le savoir faire pour utiliser tout ceci correctement !
Dans le doute, prévoyez toujours plus de marge que moins. Et gardez de quoi manger (autre chose que deux fruits secs qui se battent en duel dans une poche). Pour plus de conseils, consultez également notre article : comment bien choisir son sac de trek.
Conclusion : le bon sentier, c’est celui que vous êtes prêt à suivre
On ne compte plus les anecdotes de randonneurs partis en sandales sur une crête rocheuse « parce que c’était joli sur la photo ». La montagne n’est pas une appli. Elle ne se swipe pas, elle se respecte. Choisissez vos sentiers avec humilité, équipez-vous avec rigueur, et marchez avec tête, pieds… et parfois un peu le ventre aussi. Parce que oui, le bonheur est souvent au bout du sentier. Mais il est plus savoureux sans ampoules ni frayeurs.
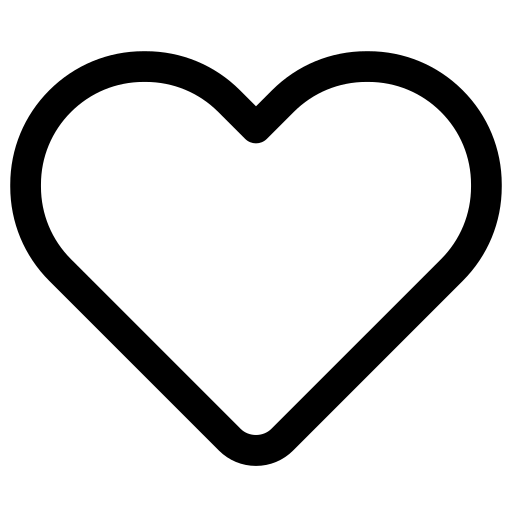 Mes favoris
Mes favoris
 Connexion
Connexion